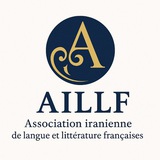Forwarded from انجمن علمی-دانشجویی فرانسه دانشگاه تربیت مدرس
🟪 انجمن علمی-دانشجویی زبان فرانسه دانشگاه تربیت مدرس با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه و انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه (AILLF) برگزار میکند:
چهارمین دوره همایش سالانه چالشهای آموزش و ترجمه زبان فرانسه در ایران، با موضوع: نقش رابطه انسانی در آموزش و ترجمه زبان فرانسه در ایران، در عصر هوش مصنوعی
📧 به آدرس: tmufrench@gmail.com
✅ زمان اعلام پذیرش آثار: ۱ شهریور ۱۴۰۴
🗣 زبانهای همایش: فرانسه و فارسی
🎖همراه با ارائه گواهی معتبر از گروه فرانسه دانشگاه تربیت مدرس و انتشار مقالات ارائهکنندگان در همایشنامه دیدکترا
زمان برگزاری:
📆 دوشنبه ۲۸ مهرماه
⏰ از ساعت ۹ الی ۱۳
📍محل برگزاری: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی
📢 اطلاعات بیشتر و آخرین اخبار
#انجمن_علمی_دانشجویی_گروه_فرانسه_1403
#دانشگاه_تربیت_مدرس
چهارمین دوره همایش سالانه چالشهای آموزش و ترجمه زبان فرانسه در ایران، با موضوع: نقش رابطه انسانی در آموزش و ترجمه زبان فرانسه در ایران، در عصر هوش مصنوعی
زبان فرانسه در بخش آموزشی آن به عنوان زبان دوم، به کیفیت روابط انسانی میان معلم و زبانآموز، و در بخش ترجمه نیز میان مترجم و مخاطب وابسته است.⌛️ مهلت ارسال چکیده مقالات: تا ۲۰ مرداد ۱۴۰۴
این روابط، که مبتنی بر تعاملات عاطفی، فرهنگی و حرفهای هستند، نقشی کلیدی در انتقال مؤثر دانش زبانی و جنبههای فرهنگی ایفا میکنند.
با این حال، در عصر هوش مصنوعی، ابزارهای دیجیتال و فناوریهای نوین، روشهای سنتی آموزش و ترجمه به طور چشمگیری متحول شدهاند.
این ابزارها، از نرمافزارهای ترجمه خودکار تا پلتفرمهای آموزشی آنلاین، ضمن ارائه فرصتهای جدید، چالشهایی را نیز به همراه داشتهاند.
در همین راستا، بررسی نقش رابطه انسانی در آموزش و ترجمه زبان فرانسه در مواجهه با این انقلاب دیجیتال از اهمیت بالایی برخوردار است.
همایش "چالشهای آموزش و ترجمه زبان فرانسه در ایران" به دنبال تحلیل این تعامل، بررسی جنبههای مثبت و منفی و همچنین کاوش در تحولات بالقوهای است که میتوانند تعادل میان فناوری و روابط انسانی را در این حوزه تقویت کند.
در روزگاری که به طور فزایندهای رو به دیجیتالی شدن در حرکت است، حفظ و تقویت جنبههای انسانی در فرآیندهای آموزش و ترجمه، نه تنها به حفظ اصالت و کیفیت این فعالیتها کمک میکند، بلکه میتواند به خلق رویکردهای نوآورانهای منجر شود که فناوری و روابط انسانی را به طور همافزا در خدمت ارتقای یادگیری و انتقال فرهنگی قرار دهد.
از این رو، این همایش سالیانه با موضوع "نقش رابطه انسانی در آموزش و ترجمه زبان فرانسه در ایران، در عصر هوش مصنوعی" منتظر دریافت مقالات شما میباشد.
📧 به آدرس: tmufrench@gmail.com
✅ زمان اعلام پذیرش آثار: ۱ شهریور ۱۴۰۴
🗣 زبانهای همایش: فرانسه و فارسی
🎖همراه با ارائه گواهی معتبر از گروه فرانسه دانشگاه تربیت مدرس و انتشار مقالات ارائهکنندگان در همایشنامه دیدکترا
زمان برگزاری:
📆 دوشنبه ۲۸ مهرماه
⏰ از ساعت ۹ الی ۱۳
📍محل برگزاری: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی
📢 اطلاعات بیشتر و آخرین اخبار
#انجمن_علمی_دانشجویی_گروه_فرانسه_1403
#دانشگاه_تربیت_مدرس
👍7❤2
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
تو را دوست میدارم
شعر #پل_الوار
ترجمه احمد شاملو
دکلمه: فریدون فرحاندوز
به ما بپیوندید 👇
@AILLF
شعر #پل_الوار
ترجمه احمد شاملو
دکلمه: فریدون فرحاندوز
به ما بپیوندید 👇
@AILLF
❤6🔥1👏1
انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه(AILLF)
@AILLF
Le poète (non pas un poète en particulier, mais le concept de poète) n’est ni un religieux, ni un philosophe. Et pourtant, la pratique de la poésie peut parfois être rapprochée d’une posture méditative, distincte cependant de celle de ces deux figures. Le poète, lors qu’il se fait méditant, l’est à sa manière. C’est ce que j’ai essayé de montrer en co-dirigeant un colloque, dont les actes sont parus chez Classiques Garnier, sur La poésie comme espace méditatif. Et c’est de quoi je voudrais vous entretenir aujourd’hui, d’une façon plus accessible et moins formelle.
De la poésie comme nécessité
On peut partir du constat que, pour la quasi-totalité des poètes, écrire est une nécessité vitale. C’est bien plus qu’un métier (de toute manière, les vers ne rapportent rien), bien plus qu’un loisir (on n’écrit pas de la poésie simplement pour se détendre). Le poète est comme requis par les mots. La poésie est sa raison d’être. Lui interdire la poésie, si cela était possible, ce serait le tuer.
Rainer Maria Rilke ne dit pas autre chose dans sa Lettre à un jeune poète :
"Personne ne peut vous conseiller ni vous aider, personne. Il n'est qu'un seul moyen. Rentrez en vous-même. Cherchez la raison qui, au fond, vous commande d'écrire ; examinez si elle déploie ses racines jusqu'au lieu le plus profond de votre cœur ; reconnaissez-le face à vous-même : vous faudrait-il mourir s'il vous était interdit d'écrire ? Ceci surtout : demandez-vous à l'heure la plus silencieuse de votre nuit : dois-je écrire ? Creusez en vous-même vers une réponse profonde. Et si cette réponse devait être affirmative, s'il vous est permis d'aller à la rencontre de cette question sérieuse avec un fort et simple «je dois», alors construisez votre vie selon cette nécessité ; votre vie, jusqu'en son heure la plus indifférente, la plus infime, doit se faire signe et témoignage pour cette poussée."
Écrire est donc l’activité la plus vitale, la plus engageante, la plus nécessaire qui soit pour un poète. Elle n’est pas simplement une activité parmi d’autres, elle exige, si l’on en croit Rilke, un engagement total. Son enjeu dépasse donc les objectifs immanents et mondains que l’on peut imaginer : on n’écrit pas seulement pour plaire à un auditoire, on n’écrit pas seulement pour défendre des idées, on n’écrit pas seulement pour les satisfactions que cela procure, et même, on n’écrit pas seulement pour laisser une trace de notre existence à la postérité. On écrit, tout simplement, parce qu’il le faut, parce qu’on le doit, parce que c’est la seule chose qui importe vraiment. On dit souvent, en rappelant son étymologie, que la poésie est un faire ; elle est tout autant, sinon davantage, une façon d’être.
La poésie comme façon d’être se situe, pour Rilke, dans le « lieu le plus profond » du cœur. L’adjectif « profond » métaphorise l’intériorité, le point le plus intime de l’âme. Le poète est ainsi invité à faire sourdre ses mots d’un lieu qui n’a pas d’existence physique, et qu’on pourrait appeler un espace méditatif.
Qu’est-ce que méditer en poète ?
Lorsque l’on parle habituellement de méditation, on fait référence à une pratique qui est soit d’ordre philosophique, soit d’ordre spirituel, mais, généralement, on ne pense pas au poète. Certes, Lamartine a écrit des Méditations poétiques, mais, souvent, on ne présente pas le poète comme un méditant, alors que la méditation poétique est peut-être une troisième forme de méditation, à côté de la méditation philosophique (qui est une réflexion nourrie de concepts) et de la méditation spirituelle (qui est le fait de se relier à une transcendance). Il ne s’agit pas de faire du poète un philosophe ou un mystique : si méditation poétique il y a, elle se distingue des autres formes de méditation par ses enjeux propres, tout en pouvant emprunter aux deux autres puisqu’il y a des poètes philosophes et des poètes mystiques.
Dans mon article, je prends différents exemples dans la poésie française moderne et contemporaine, pour souligner l’importance d’un état de disponibilité totale à ce qui est, chez plusieurs poètes.
@AILLF
De la poésie comme nécessité
On peut partir du constat que, pour la quasi-totalité des poètes, écrire est une nécessité vitale. C’est bien plus qu’un métier (de toute manière, les vers ne rapportent rien), bien plus qu’un loisir (on n’écrit pas de la poésie simplement pour se détendre). Le poète est comme requis par les mots. La poésie est sa raison d’être. Lui interdire la poésie, si cela était possible, ce serait le tuer.
Rainer Maria Rilke ne dit pas autre chose dans sa Lettre à un jeune poète :
"Personne ne peut vous conseiller ni vous aider, personne. Il n'est qu'un seul moyen. Rentrez en vous-même. Cherchez la raison qui, au fond, vous commande d'écrire ; examinez si elle déploie ses racines jusqu'au lieu le plus profond de votre cœur ; reconnaissez-le face à vous-même : vous faudrait-il mourir s'il vous était interdit d'écrire ? Ceci surtout : demandez-vous à l'heure la plus silencieuse de votre nuit : dois-je écrire ? Creusez en vous-même vers une réponse profonde. Et si cette réponse devait être affirmative, s'il vous est permis d'aller à la rencontre de cette question sérieuse avec un fort et simple «je dois», alors construisez votre vie selon cette nécessité ; votre vie, jusqu'en son heure la plus indifférente, la plus infime, doit se faire signe et témoignage pour cette poussée."
Écrire est donc l’activité la plus vitale, la plus engageante, la plus nécessaire qui soit pour un poète. Elle n’est pas simplement une activité parmi d’autres, elle exige, si l’on en croit Rilke, un engagement total. Son enjeu dépasse donc les objectifs immanents et mondains que l’on peut imaginer : on n’écrit pas seulement pour plaire à un auditoire, on n’écrit pas seulement pour défendre des idées, on n’écrit pas seulement pour les satisfactions que cela procure, et même, on n’écrit pas seulement pour laisser une trace de notre existence à la postérité. On écrit, tout simplement, parce qu’il le faut, parce qu’on le doit, parce que c’est la seule chose qui importe vraiment. On dit souvent, en rappelant son étymologie, que la poésie est un faire ; elle est tout autant, sinon davantage, une façon d’être.
La poésie comme façon d’être se situe, pour Rilke, dans le « lieu le plus profond » du cœur. L’adjectif « profond » métaphorise l’intériorité, le point le plus intime de l’âme. Le poète est ainsi invité à faire sourdre ses mots d’un lieu qui n’a pas d’existence physique, et qu’on pourrait appeler un espace méditatif.
Qu’est-ce que méditer en poète ?
Lorsque l’on parle habituellement de méditation, on fait référence à une pratique qui est soit d’ordre philosophique, soit d’ordre spirituel, mais, généralement, on ne pense pas au poète. Certes, Lamartine a écrit des Méditations poétiques, mais, souvent, on ne présente pas le poète comme un méditant, alors que la méditation poétique est peut-être une troisième forme de méditation, à côté de la méditation philosophique (qui est une réflexion nourrie de concepts) et de la méditation spirituelle (qui est le fait de se relier à une transcendance). Il ne s’agit pas de faire du poète un philosophe ou un mystique : si méditation poétique il y a, elle se distingue des autres formes de méditation par ses enjeux propres, tout en pouvant emprunter aux deux autres puisqu’il y a des poètes philosophes et des poètes mystiques.
Dans mon article, je prends différents exemples dans la poésie française moderne et contemporaine, pour souligner l’importance d’un état de disponibilité totale à ce qui est, chez plusieurs poètes.
@AILLF
❤5
انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه(AILLF)
Le poète (non pas un poète en particulier, mais le concept de poète) n’est ni un religieux, ni un philosophe. Et pourtant, la pratique de la poésie peut parfois être rapprochée d’une posture méditative, distincte cependant de celle de ces deux figures. Le…
Cette disponibilité apparaît comme un état méditatif par lequel le poète tente de percevoir et d’exprimer les choses telles qu’elles sont, et non telles qu’on a l’habitude de les voir. Être disponible aux choses et aux êtres, c’est en d’autres termes être capable d’accueillir la réalité telle qu’elle est, c’est être à l’écoute de nos sens, sans y apposer d’emblée l’écran de nos pensées et de notre jugement.
Arthur Rimbaud dans « Sensation », Antoine Émaz lorsqu’il décrit son jardin, Jean-Michel Maulpoix lorsqu’il propose un « apprentissage de la lenteur » ou lorsqu’il marche à pas feutrés dans la neige, Yves Bonnefoy lors qu’il trouve le « vrai lieu » dans la neige, Philippe Jaccottet dans un très grand nombre de ses poèmes, Salah Stétié auteur de Carnets du méditant, Marie-Claire Bancquart lorsqu’elle contemple un insecte ou le soleil couchant, Béatrice Bonhomme aussi en certains points de son œuvre… Nombreux sont les poètes contemporains dont l’œuvre intègre une dimension méditative.
L’éclairage de la notion de « pleine conscience »
Plusieurs psychologues et psychiatres contemporains, notamment Jon Kabat-Zinn aux États-Unis et Christophe André en France, se sont intéressés à la méditation bouddhiste et ont jugé que celle-ci comportait des éléments transférables à l’Occident, afin de lutter contre la dépression et plus largement contre le stress, grands maux de notre siècle. Des études scientifiques tendent à montrer un effet positif de la méditation de pleine conscience sur la dépression. Il n’est pas de ma spécialité de juger l’efficacité de leur méthode, même si à titre personnel je pense qu’elle peut faire du bien, en revanche je pense que leur approche peut aider à mieux définir ce que l’on entend par méditation, et à trouver des points de convergence entre méditation et pratique poétique.
Ces psychologues insistent sur la notion de « pleine conscience » (mindfulness). Par cette expression, ils désignent une attitude d’esprit qui accueille ce qui est, sans jugement. Il ne s’agit pas de « ne pas penser » ou de « faire le vide » : de toute manière, notre cerveau pense. Mais au lieu de le laisser ruminer des scénarios passés ou à venir de façon non constructive, il s’agit d’ouvrir son attention à l’instant présent, à la diversité des sensations qui parviennent de nos sens, sans émettre de jugement de valeur. On ne peut pas s’empêcher de penser, mais on peut s’empêcher de juger. Les choses sont ce qu’elles sont. Le regret, la tristesse, l’angoisse, le stress, l’attente sont des états mentaux qui portent le plus souvent sur des représentations de situations passées ou futures, et non sur la réalité. Au contraire, la joie, le bonheur, le calme sont des états mentaux où notre esprit s’ouvre à l’instant présent.
Être pleinement conscient, c’est adopter la posture d’observateur plutôt que d’acteur. On peut penser au non-agir chinois (wu-wei). Au lieu d’être dans l’arène, dans la fosse aux lions, il s’agit de se regarder agir et penser, d’avoir ce recul-là, pour observer, juger, décider, et non plus foncer tête baissée. Nous sommes très souvent mûs par des torrents d’émotions qui nous submergent, téléguidés par des pulsions, des désirs. Il s’agit d’en prendre conscience, afin de ne plus subir nos états mentaux, en les regardant de loin, de façon détachée, avec moins d’ego et plus de lucidité. Il ne s’agit pas de se couper de nos émotions, qui sont très précieuses, pour tout le monde et plus encore peut-être pour le poète, puisqu’elles sont en quelque sorte sa palette d’écriture. Simplement, on apprend à vivre ses émotions sans les subir, sans être submergé par elles, en restant maître à bord. Être conscient, c’est ajouter en nous l’observateur à l’acteur. La sérénité passe par l’acceptation pleine et entière de la réalité.
Accepter ce qui est, voir les choses pour ce qu’elles sont, sans plaquer sur elles nos doutes, nos angoisses, nos peurs, nos désirs, nos espoirs. Accepter ce qui est, cela ne signifie pas se résigner et ne rien faire pour que les choses changent.
@AILLF
Arthur Rimbaud dans « Sensation », Antoine Émaz lorsqu’il décrit son jardin, Jean-Michel Maulpoix lorsqu’il propose un « apprentissage de la lenteur » ou lorsqu’il marche à pas feutrés dans la neige, Yves Bonnefoy lors qu’il trouve le « vrai lieu » dans la neige, Philippe Jaccottet dans un très grand nombre de ses poèmes, Salah Stétié auteur de Carnets du méditant, Marie-Claire Bancquart lorsqu’elle contemple un insecte ou le soleil couchant, Béatrice Bonhomme aussi en certains points de son œuvre… Nombreux sont les poètes contemporains dont l’œuvre intègre une dimension méditative.
L’éclairage de la notion de « pleine conscience »
Plusieurs psychologues et psychiatres contemporains, notamment Jon Kabat-Zinn aux États-Unis et Christophe André en France, se sont intéressés à la méditation bouddhiste et ont jugé que celle-ci comportait des éléments transférables à l’Occident, afin de lutter contre la dépression et plus largement contre le stress, grands maux de notre siècle. Des études scientifiques tendent à montrer un effet positif de la méditation de pleine conscience sur la dépression. Il n’est pas de ma spécialité de juger l’efficacité de leur méthode, même si à titre personnel je pense qu’elle peut faire du bien, en revanche je pense que leur approche peut aider à mieux définir ce que l’on entend par méditation, et à trouver des points de convergence entre méditation et pratique poétique.
Ces psychologues insistent sur la notion de « pleine conscience » (mindfulness). Par cette expression, ils désignent une attitude d’esprit qui accueille ce qui est, sans jugement. Il ne s’agit pas de « ne pas penser » ou de « faire le vide » : de toute manière, notre cerveau pense. Mais au lieu de le laisser ruminer des scénarios passés ou à venir de façon non constructive, il s’agit d’ouvrir son attention à l’instant présent, à la diversité des sensations qui parviennent de nos sens, sans émettre de jugement de valeur. On ne peut pas s’empêcher de penser, mais on peut s’empêcher de juger. Les choses sont ce qu’elles sont. Le regret, la tristesse, l’angoisse, le stress, l’attente sont des états mentaux qui portent le plus souvent sur des représentations de situations passées ou futures, et non sur la réalité. Au contraire, la joie, le bonheur, le calme sont des états mentaux où notre esprit s’ouvre à l’instant présent.
Être pleinement conscient, c’est adopter la posture d’observateur plutôt que d’acteur. On peut penser au non-agir chinois (wu-wei). Au lieu d’être dans l’arène, dans la fosse aux lions, il s’agit de se regarder agir et penser, d’avoir ce recul-là, pour observer, juger, décider, et non plus foncer tête baissée. Nous sommes très souvent mûs par des torrents d’émotions qui nous submergent, téléguidés par des pulsions, des désirs. Il s’agit d’en prendre conscience, afin de ne plus subir nos états mentaux, en les regardant de loin, de façon détachée, avec moins d’ego et plus de lucidité. Il ne s’agit pas de se couper de nos émotions, qui sont très précieuses, pour tout le monde et plus encore peut-être pour le poète, puisqu’elles sont en quelque sorte sa palette d’écriture. Simplement, on apprend à vivre ses émotions sans les subir, sans être submergé par elles, en restant maître à bord. Être conscient, c’est ajouter en nous l’observateur à l’acteur. La sérénité passe par l’acceptation pleine et entière de la réalité.
Accepter ce qui est, voir les choses pour ce qu’elles sont, sans plaquer sur elles nos doutes, nos angoisses, nos peurs, nos désirs, nos espoirs. Accepter ce qui est, cela ne signifie pas se résigner et ne rien faire pour que les choses changent.
@AILLF
❤3👍1
انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه(AILLF)
Cette disponibilité apparaît comme un état méditatif par lequel le poète tente de percevoir et d’exprimer les choses telles qu’elles sont, et non telles qu’on a l’habitude de les voir. Être disponible aux choses et aux êtres, c’est en d’autres termes être…
Mais pour être capable de changer les choses, il faut d’abord les voir pour ce qu’elles sont, accepter la situation présente et ensuite seulement agir. Les stoïciens distinguaient ce qui dépend de nous, sur lequel nous pouvons agir, et ce qui ne dépend pas de nous, contre lequel il est inutile de s’épuiser.
Il me semble que de tels états méditatifs, où le poète est ouvert à la réalité telle qu’elle est, disponible à ce qui se trouve en lui et autour de lui, apparaissent dans la poésie contemporaine, et sont même essentiels à toute pratique poétique authentique, dans la mesure où la poésie, au lieu de répéter les lieux communs, cherche à dire le monde avec la plus grande justesse.
La « cascade céleste » de Philippe Jaccottet
Philippe Jaccottet photographié par Erling Mandelmann (Wikipédia)
Quand Philippe Jaccottet, parvenu au sommet d’une montagne, contemple le monde qu’il domine de sa position surplombante, en se sentant comme immergé dans une « cascade céleste », il atteint un état de sérénité qui s’exprime à travers le lexique de la légèreté aérienne. Cette altitude physique s’accompagne en somme d’une prise de hauteur psychologique ou spirituelle si l’on veut. « J’y crois la mort comprise », dit Philippe Jaccottet, comme si, en cet instant, plus rien, pas même la mort, ne pouvait troubler son esprit. Le poète est totalement absorbé dans une contemplation où les tracas et les soucis perdent de leur importance. Il est totalement disponible à ce qui est, ouvert à la réalité telle qu’elle se présente, en ce lieu lumineux et aérien propice à la méditation.
Philippe Jaccottet isole sur le vers les participes « regardant / écoutant ». Cela me semble très caractéristique d’une posture méditative, puisque la perception est ce qui importe, et non le jugement du petit moi. Il s’agit bien d’une pleine conscience de l’instant présent, où se taisent les ruminations mentales. Le « je » lui-même est comme effacé, absorbé par plus grand que lui, « couché dans la chevelure de l’air », comme intégré à cet espace même qu’il contemple.
Et moi maintenant tout entier dans la cascade céleste,
de haut en bas couché dans la chevelure de l’air
ici, l’égal des feuilles les plus lumineuses,
suspendu à peine moins haut que la buse,
regardant,
écoutant
(et les papillons sont autant de flammes perdues,
les montagnes autant de fumées) —
un instant, d’embrasser le cercle entier du ciel
autour de moi, j’y crois la mort comprise.
Je ne vois presque plus rien que la lumière,
les cris d’oiseaux lointains en sont les nœuds,
toute la montagne du jour est allumée,
elle ne me surplombe plus,
elle m’enflamme.
Philippe Jaccottet
La neige d’Yves Bonnefoy
Yves Bonnefoy est un poète de la même génération que Philippe Jaccottet, né dans les années vingt et publiant ses premiers recueils dans les années cinquante, décédé comme lui il y a quelques années. Il cherche par la poésie à collecter les parcelles d’espoir qu’il subsiste après la Deuxième guerre mondiale. Parmi ses recueils, mon préféré est Début et fin de la neige, qui n’est pas l’un des plus connus, mais qui est l’un de ceux où apparaît, à mon sens, une posture méditative.
J'avance alors, jusque sous l'arche d'une porte.
Les flocons tourbillonnent, effaçant
La limite entre le dehors et cette salle
Où des lampes sont allumées : mais elles-mêmes
Une sorte de neige, qui hésite
Entre le haut, le bas, dans cette nuit.
C'est comme si j'étais sur un second seuil.
Et au-delà ce même bruit d'abeilles
Dans le bruit de la neige. Ce que disaient
Les abeilles sans nombre de l'été.
Yves Bonnefoy, Début et fin de la neige
J’ai commenté, il y a quelque temps, un poème de ce recueil intitulé « Hopkins forest », et qui illustre mon propos. Citons encore :
Et là-haut je ne sais si c’est la vie
Encore, ou la joie seule, qui se détache
Il me semble que de tels états méditatifs, où le poète est ouvert à la réalité telle qu’elle est, disponible à ce qui se trouve en lui et autour de lui, apparaissent dans la poésie contemporaine, et sont même essentiels à toute pratique poétique authentique, dans la mesure où la poésie, au lieu de répéter les lieux communs, cherche à dire le monde avec la plus grande justesse.
La « cascade céleste » de Philippe Jaccottet
Philippe Jaccottet photographié par Erling Mandelmann (Wikipédia)
Quand Philippe Jaccottet, parvenu au sommet d’une montagne, contemple le monde qu’il domine de sa position surplombante, en se sentant comme immergé dans une « cascade céleste », il atteint un état de sérénité qui s’exprime à travers le lexique de la légèreté aérienne. Cette altitude physique s’accompagne en somme d’une prise de hauteur psychologique ou spirituelle si l’on veut. « J’y crois la mort comprise », dit Philippe Jaccottet, comme si, en cet instant, plus rien, pas même la mort, ne pouvait troubler son esprit. Le poète est totalement absorbé dans une contemplation où les tracas et les soucis perdent de leur importance. Il est totalement disponible à ce qui est, ouvert à la réalité telle qu’elle se présente, en ce lieu lumineux et aérien propice à la méditation.
Philippe Jaccottet isole sur le vers les participes « regardant / écoutant ». Cela me semble très caractéristique d’une posture méditative, puisque la perception est ce qui importe, et non le jugement du petit moi. Il s’agit bien d’une pleine conscience de l’instant présent, où se taisent les ruminations mentales. Le « je » lui-même est comme effacé, absorbé par plus grand que lui, « couché dans la chevelure de l’air », comme intégré à cet espace même qu’il contemple.
Et moi maintenant tout entier dans la cascade céleste,
de haut en bas couché dans la chevelure de l’air
ici, l’égal des feuilles les plus lumineuses,
suspendu à peine moins haut que la buse,
regardant,
écoutant
(et les papillons sont autant de flammes perdues,
les montagnes autant de fumées) —
un instant, d’embrasser le cercle entier du ciel
autour de moi, j’y crois la mort comprise.
Je ne vois presque plus rien que la lumière,
les cris d’oiseaux lointains en sont les nœuds,
toute la montagne du jour est allumée,
elle ne me surplombe plus,
elle m’enflamme.
Philippe Jaccottet
La neige d’Yves Bonnefoy
Yves Bonnefoy est un poète de la même génération que Philippe Jaccottet, né dans les années vingt et publiant ses premiers recueils dans les années cinquante, décédé comme lui il y a quelques années. Il cherche par la poésie à collecter les parcelles d’espoir qu’il subsiste après la Deuxième guerre mondiale. Parmi ses recueils, mon préféré est Début et fin de la neige, qui n’est pas l’un des plus connus, mais qui est l’un de ceux où apparaît, à mon sens, une posture méditative.
J'avance alors, jusque sous l'arche d'une porte.
Les flocons tourbillonnent, effaçant
La limite entre le dehors et cette salle
Où des lampes sont allumées : mais elles-mêmes
Une sorte de neige, qui hésite
Entre le haut, le bas, dans cette nuit.
C'est comme si j'étais sur un second seuil.
Et au-delà ce même bruit d'abeilles
Dans le bruit de la neige. Ce que disaient
Les abeilles sans nombre de l'été.
Yves Bonnefoy, Début et fin de la neige
J’ai commenté, il y a quelque temps, un poème de ce recueil intitulé « Hopkins forest », et qui illustre mon propos. Citons encore :
Et là-haut je ne sais si c’est la vie
Encore, ou la joie seule, qui se détache
Littérature Portes Ouvertes
« Hopkins forest » d’Yves Bonnefoy
Depuis les années cinquante jusqu’à sa mort en 2016, Yves Bonnefoy n’aura eu de cesse de poursuivre l’idéal d’une poésie tout à la fois simple et authentique. En 1991, il pu…
❤7
انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه(AILLF)
Mais pour être capable de changer les choses, il faut d’abord les voir pour ce qu’elles sont, accepter la situation présente et ensuite seulement agir. Les stoïciens distinguaient ce qui dépend de nous, sur lequel nous pouvons agir, et ce qui ne dépend pas…
Par la grâce des nombres
Le poids de la naissance dans l’exil,
Mais de la neige s’y est mise et s’y entasse,
Je m’approche de l’une d’elles, la plus basse,
Je fais tomber un peu de sa lumière,
Et soudain c’est le pré de mes dix ans,
Les abeilles bourdonnent,
Ce que j’ai dans mes mains, ces fleurs, ces ombres,
Est-ce presque du miel, est-ce de la neige ?
Plusieurs poèmes ont en commun de présenter la neige comme une expérience singulière, un espace-temps qui ouvre sur une sorte de révélation simple. Le poète parle lui-même d’un « seuil », et même si ce seuil peut être un « leurre », il y a malgré tout l’idée d’une ouverture sur quelque chose qui n’est pas forcément la vérité, qui n’est pas forcément transcendant, mais qui invite à la contemplation. Le poète est tout entier absorbé par cette expérience singulière, source de joie, accession à un mode d’être autre, à une autre réalité peut-être. C’est en étant ouvert à ses perceptions, à ses sensations (« Ce que je vois ») que le poète parvient à cette vision sereine au sein de laquelle surgit l’enfance.
La poésie de Michèle Finck
Michèle Finck, par ailleurs grande spécialiste de Bonnefoy, écrit à partir d’événements graves de sa vie : la mort de son père, la maladie psychiatrique de l’être aimé… Cela aurait pu donner lieu à une poésie très sombre, très pessimiste, et cela n’est précisément pas le cas. Je pense que c’est une posture méditative qui permet à la poète d’accepter ce qui est, et de voir que tout n’est pas noir. Chez Michèle Finck, cela passe notamment par l’écoute, l’entendre, la musique. La dimension auditive est primordiale pour elle.
« Apprentissage de la lenteur » chez Jean-Michel Maulpoix
Dans Chutes de pluie fine, Jean-Michel Maulpoix rapporte ses nombreux voyages tout autour du monde, sa façon d’être toujours en partance, en transit, ne posant ses valises jamais longtemps, parcourant le monde sans taire sa misère, sa violence et ses ruines, mais disant aussi sa fascinante beauté. Et vers la fin du recueil, le poète se met en quête du « pays natal ». La dernière section est beaucoup plus sereine que les précédentes. Et l’un des poèmes s’intitule « Apprentissage de la lenteur ». Le poète prend le temps d’observer le paysage, simple, banal, avec une rivière et des canetons. Le poète semble, pour une fois, en phase avec ce paysage, et cet apprentissage de la lenteur se lit comme une posture méditative, un temps de paix, comme il s’en retrouve d’autres dans son oeuvre, notamment dans Pas sur la neige.
La marche méditative chez Arnaud Villani
J’ai déjà commenté il y a quelque temps Être avec le sauvage d’Arnaud Villani. Je ne m’attarderai donc pas ici à présenter cet essai lumineux, sinon pour dire que philosophie et poésie s’y fondent dans une même disposition d’esprit, qui à mon sens peut être dite méditative. Y apparaît un rapport avec la nature qui n’est plus d’opposition comme trop souvent, mais d’adhésion, d’inclusion, voire de fusion. Le philosophe-poète ne fait plus qu’un avec l’arbre, avec le sol, avec la marche, et cela, parce qu’il est parfaitement disponible à ce qui est, tout entier ouvert aux sens et aux sensations. Cet état de disponibilité totale à ce qui est instaure une forme de communion avec la nature. La philosophie ne consiste plus alors à échafauder de complexes systèmes de concepts, mais à vivre tout simplement l’instant présent, à accueillir la réalité telle qu’elle se présente, à marcher et respirer dans la forêt.
☆
Il y aurait de nombreux autres exemples à mentionner. J’en ai ici présenté d’autres que ceux évoqués dans mon article universitaire, où je parlais d’Antoine Émaz, de Pierre Dhainaut, de Marie-Claire Bancquart… On pourrait ajouter Salah Stétié, auteur de Carnets du méditant composés de notes brèves, proches du haïku dans leur forme, et nourris par les deux cultures occidentale et islamique. Et tant d’autres.
@AILLF
Le poids de la naissance dans l’exil,
Mais de la neige s’y est mise et s’y entasse,
Je m’approche de l’une d’elles, la plus basse,
Je fais tomber un peu de sa lumière,
Et soudain c’est le pré de mes dix ans,
Les abeilles bourdonnent,
Ce que j’ai dans mes mains, ces fleurs, ces ombres,
Est-ce presque du miel, est-ce de la neige ?
Plusieurs poèmes ont en commun de présenter la neige comme une expérience singulière, un espace-temps qui ouvre sur une sorte de révélation simple. Le poète parle lui-même d’un « seuil », et même si ce seuil peut être un « leurre », il y a malgré tout l’idée d’une ouverture sur quelque chose qui n’est pas forcément la vérité, qui n’est pas forcément transcendant, mais qui invite à la contemplation. Le poète est tout entier absorbé par cette expérience singulière, source de joie, accession à un mode d’être autre, à une autre réalité peut-être. C’est en étant ouvert à ses perceptions, à ses sensations (« Ce que je vois ») que le poète parvient à cette vision sereine au sein de laquelle surgit l’enfance.
La poésie de Michèle Finck
Michèle Finck, par ailleurs grande spécialiste de Bonnefoy, écrit à partir d’événements graves de sa vie : la mort de son père, la maladie psychiatrique de l’être aimé… Cela aurait pu donner lieu à une poésie très sombre, très pessimiste, et cela n’est précisément pas le cas. Je pense que c’est une posture méditative qui permet à la poète d’accepter ce qui est, et de voir que tout n’est pas noir. Chez Michèle Finck, cela passe notamment par l’écoute, l’entendre, la musique. La dimension auditive est primordiale pour elle.
« Apprentissage de la lenteur » chez Jean-Michel Maulpoix
Dans Chutes de pluie fine, Jean-Michel Maulpoix rapporte ses nombreux voyages tout autour du monde, sa façon d’être toujours en partance, en transit, ne posant ses valises jamais longtemps, parcourant le monde sans taire sa misère, sa violence et ses ruines, mais disant aussi sa fascinante beauté. Et vers la fin du recueil, le poète se met en quête du « pays natal ». La dernière section est beaucoup plus sereine que les précédentes. Et l’un des poèmes s’intitule « Apprentissage de la lenteur ». Le poète prend le temps d’observer le paysage, simple, banal, avec une rivière et des canetons. Le poète semble, pour une fois, en phase avec ce paysage, et cet apprentissage de la lenteur se lit comme une posture méditative, un temps de paix, comme il s’en retrouve d’autres dans son oeuvre, notamment dans Pas sur la neige.
La marche méditative chez Arnaud Villani
J’ai déjà commenté il y a quelque temps Être avec le sauvage d’Arnaud Villani. Je ne m’attarderai donc pas ici à présenter cet essai lumineux, sinon pour dire que philosophie et poésie s’y fondent dans une même disposition d’esprit, qui à mon sens peut être dite méditative. Y apparaît un rapport avec la nature qui n’est plus d’opposition comme trop souvent, mais d’adhésion, d’inclusion, voire de fusion. Le philosophe-poète ne fait plus qu’un avec l’arbre, avec le sol, avec la marche, et cela, parce qu’il est parfaitement disponible à ce qui est, tout entier ouvert aux sens et aux sensations. Cet état de disponibilité totale à ce qui est instaure une forme de communion avec la nature. La philosophie ne consiste plus alors à échafauder de complexes systèmes de concepts, mais à vivre tout simplement l’instant présent, à accueillir la réalité telle qu’elle se présente, à marcher et respirer dans la forêt.
☆
Il y aurait de nombreux autres exemples à mentionner. J’en ai ici présenté d’autres que ceux évoqués dans mon article universitaire, où je parlais d’Antoine Émaz, de Pierre Dhainaut, de Marie-Claire Bancquart… On pourrait ajouter Salah Stétié, auteur de Carnets du méditant composés de notes brèves, proches du haïku dans leur forme, et nourris par les deux cultures occidentale et islamique. Et tant d’autres.
@AILLF
🙏3
Forwarded from انجمن علمی زبان فرانسه دانشگاه اصفهان
📣 انجمن علمی زبان فرانسه دانشگاه اصفهان برگزار میکند:
کارگاه آنلاین آشنایی با منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان فرانسه
👤مدرس: خانم دکتر سمیرا دلداده
دکتری زبان و ادبیات و فرانسه و استاد مدعو گروه فرانسه دانشگاه اصفهان
📝 مواردی که در کارگاه به آنها پرداخته خواهد شد:
🔹 راهنمایی دانشجویان برای برنامهریزی صحیح مطالعاتی
🔹 معرفی منابع معتبر آزمون
🔹 پرسش و پاسخ در خصوص آزمون و منابع آن
📅 تاریخ : شنبه ۴ مرداد
🕰 ساعت برگزاری: ساعت ۲۰
❗️کارگاه در بستر گوگل میت برگزار خواهد شد
‼️هزینه: رایگان!
🖇 ثبت نام و اطلاعات بیشتر از طریق :
🆔 @Melika_1680
📚 Association Scientifique de Langue Française de l’Université d’Ispahan
با ما همراه باشید در:
تلگرام ☘ اینستاگرام ☘ ایتا
کارگاه آنلاین آشنایی با منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان فرانسه
👤مدرس: خانم دکتر سمیرا دلداده
دکتری زبان و ادبیات و فرانسه و استاد مدعو گروه فرانسه دانشگاه اصفهان
📝 مواردی که در کارگاه به آنها پرداخته خواهد شد:
🔹 راهنمایی دانشجویان برای برنامهریزی صحیح مطالعاتی
🔹 معرفی منابع معتبر آزمون
🔹 پرسش و پاسخ در خصوص آزمون و منابع آن
📅 تاریخ : شنبه ۴ مرداد
🕰 ساعت برگزاری: ساعت ۲۰
❗️کارگاه در بستر گوگل میت برگزار خواهد شد
‼️هزینه: رایگان!
🖇 ثبت نام و اطلاعات بیشتر از طریق :
🆔 @Melika_1680
📚 Association Scientifique de Langue Française de l’Université d’Ispahan
با ما همراه باشید در:
تلگرام ☘ اینستاگرام ☘ ایتا
❤7👏1
انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه(AILLF)
@AILLF
Hugo von Hofmannsthal et l’art du théâtre : une traduction inédite par Jean-Yves Masson
C’est un événement discret, mais de ceux qui comptent : cet automne, paraîtra aux éditions de la Coopérative une traduction inédite de L’Aventurier et la Cantatrice,une pièce du grand écrivain autrichien Hugo von Hofmannsthal. Le texte, jamais encore proposé en français, est présenté, traduit et édité par Jean-Yves Masson, professeur de littérature comparée à la Sorbonne, écrivain, traducteur et éditeur passionné par la transmission des œuvres européennes.
Mes études très franco-françaises ne m’ont guère initié à la littérature étrangère, et c’est grâce à Jean-Yves Masson que j’ai découvert la poésie de Hofmannsthal, dont il est traducteur.
Hugo von Hofmannsthal
Qui était Hugo von Hofmannsthal ? C’était l’un des écrivains les plus importants de l’Autriche de la fin du XIXe siècle et du début du XXe. Bien que peu connu du grand public en France, il a marqué la littérature germanophone par sa poésie, ses pièces de théâtre et ses collaborations avec le compositeur Richard Strauss, pour lequel il fut librettiste.
Cette nouvelle pièce s’intitule L’aventurier et la cantatrice. Pour Jean-Yves Masson, il s’agit de l’une des plus belles que Hofmannsthal ait écrites, à l’âge de 24 ans seulement. « Cette comédie vénitienne, inspirée d’un épisode des mémoires de Casanova, est une déclaration d’amour à la musique et à l’opéra », nous dit le traducteur. Voilà qui est alléchant, n’est-ce pas ?
Jean-Yves Masson, poète, chercheur, éditeur, traducteur
Ce n’est pas un hasard si Jean-Yves Masson s’est tourné vers Hofmannsthal. Lui-même poète, romancier, critique et traducteur de l’allemand (Hofmannsthal, Rilke), du latin, de l’italien (Luzi) et de l’irlandais (Yeats), il poursuit depuis plusieurs décennies, quel qu’en soit le support, une réflexion attentive aux voix de l’Europe, à ses dialogues intérieurs, à ses résonances perdues ou méconnues. Sa pratique de la traduction, toujours précise, sensible et nourrie d’une réflexion profonde sur le texte, s’inscrit dans une conception haute de la traductologie : non comme un simple exercice de transfert linguistique, mais comme un acte d’interprétation créatrice, une forme d’hospitalité littéraire. Traduire, c’est en effet entrer dans l’intimité de l’œuvre étrangère tout en lui offrant une nouvelle respiration dans la langue d’accueil.
C’est toujours avec plaisir et intérêt que je lis les publications de Jean-Yves Masson sur les réseaux, et que je suis l’actualité de ses travaux. J’ai d’ailleurs rendu compte de plusieurs de ses ouvrages dans ce blog, et y ai également publié un entretien dans lequel il a eu des propos passionnants sur la littérature d’aujourd’hui. J’ai aussi beaucoup aimé La fée aux larmes qui est un conte magnifique.
C’est pourquoi je ne doute pas que Jean-Yves Masson mettra tous ses talents de traducteur et d’éditeur au service de l’oeuvre de Hofmannsthal, dont il est spécialiste, et ce n’est pas risquer grand-chose que de parier sur la qualité tant du contenu que de l’objet livre lui-même, à l’image des éditions de la Coopérative, qui défendent une édition artisanale, libre et rigoureuse. Cette publication à venir constituera donc une belle occasion de (re)découvrir un auteur injustement peu lu en France, et de nous évader dans la Venise de l’époque de Casanova.
@AILLF
C’est un événement discret, mais de ceux qui comptent : cet automne, paraîtra aux éditions de la Coopérative une traduction inédite de L’Aventurier et la Cantatrice,une pièce du grand écrivain autrichien Hugo von Hofmannsthal. Le texte, jamais encore proposé en français, est présenté, traduit et édité par Jean-Yves Masson, professeur de littérature comparée à la Sorbonne, écrivain, traducteur et éditeur passionné par la transmission des œuvres européennes.
Mes études très franco-françaises ne m’ont guère initié à la littérature étrangère, et c’est grâce à Jean-Yves Masson que j’ai découvert la poésie de Hofmannsthal, dont il est traducteur.
Hugo von Hofmannsthal
Qui était Hugo von Hofmannsthal ? C’était l’un des écrivains les plus importants de l’Autriche de la fin du XIXe siècle et du début du XXe. Bien que peu connu du grand public en France, il a marqué la littérature germanophone par sa poésie, ses pièces de théâtre et ses collaborations avec le compositeur Richard Strauss, pour lequel il fut librettiste.
Cette nouvelle pièce s’intitule L’aventurier et la cantatrice. Pour Jean-Yves Masson, il s’agit de l’une des plus belles que Hofmannsthal ait écrites, à l’âge de 24 ans seulement. « Cette comédie vénitienne, inspirée d’un épisode des mémoires de Casanova, est une déclaration d’amour à la musique et à l’opéra », nous dit le traducteur. Voilà qui est alléchant, n’est-ce pas ?
Jean-Yves Masson, poète, chercheur, éditeur, traducteur
Ce n’est pas un hasard si Jean-Yves Masson s’est tourné vers Hofmannsthal. Lui-même poète, romancier, critique et traducteur de l’allemand (Hofmannsthal, Rilke), du latin, de l’italien (Luzi) et de l’irlandais (Yeats), il poursuit depuis plusieurs décennies, quel qu’en soit le support, une réflexion attentive aux voix de l’Europe, à ses dialogues intérieurs, à ses résonances perdues ou méconnues. Sa pratique de la traduction, toujours précise, sensible et nourrie d’une réflexion profonde sur le texte, s’inscrit dans une conception haute de la traductologie : non comme un simple exercice de transfert linguistique, mais comme un acte d’interprétation créatrice, une forme d’hospitalité littéraire. Traduire, c’est en effet entrer dans l’intimité de l’œuvre étrangère tout en lui offrant une nouvelle respiration dans la langue d’accueil.
C’est toujours avec plaisir et intérêt que je lis les publications de Jean-Yves Masson sur les réseaux, et que je suis l’actualité de ses travaux. J’ai d’ailleurs rendu compte de plusieurs de ses ouvrages dans ce blog, et y ai également publié un entretien dans lequel il a eu des propos passionnants sur la littérature d’aujourd’hui. J’ai aussi beaucoup aimé La fée aux larmes qui est un conte magnifique.
C’est pourquoi je ne doute pas que Jean-Yves Masson mettra tous ses talents de traducteur et d’éditeur au service de l’oeuvre de Hofmannsthal, dont il est spécialiste, et ce n’est pas risquer grand-chose que de parier sur la qualité tant du contenu que de l’objet livre lui-même, à l’image des éditions de la Coopérative, qui défendent une édition artisanale, libre et rigoureuse. Cette publication à venir constituera donc une belle occasion de (re)découvrir un auteur injustement peu lu en France, et de nous évader dans la Venise de l’époque de Casanova.
@AILLF
❤4👍1
Francophonia est ravi de vous offrir l'accès à sa prochaine conférence, animée par Roger Pilhion, en ligne.
le Jeudi 7 août 2025 à 18h (heure française)
« Le français, une langue pleine d'avenir ? »
Pour vous inscrire et recevoir le lien de connexion le jour de la conférence, cliquez sur le bouton ci-dessous et remplissez le formulaire avant le 5 août à 12h00 :
https://r.actualites.francophonia.com/mk/cl/f/sh/1t6Af4OiGsDg0mCQacDhBJzyw3UwS2/NdUEx5Af-1GZ
le Jeudi 7 août 2025 à 18h (heure française)
« Le français, une langue pleine d'avenir ? »
Pour vous inscrire et recevoir le lien de connexion le jour de la conférence, cliquez sur le bouton ci-dessous et remplissez le formulaire avant le 5 août à 12h00 :
https://r.actualites.francophonia.com/mk/cl/f/sh/1t6Af4OiGsDg0mCQacDhBJzyw3UwS2/NdUEx5Af-1GZ
❤6👍2
انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه(AILLF)
Photo
S'abreuver aux sources de la satisfaction
La plupart des entrepreneurs prennent plaisir à faire progresser leur entreprise, le tout dans un environnement qui peut paraître désordonné et imprévisible, comme dans une jungle, où pratiquement chaque niche est exploitée par un arbre, une plante, un champignon, un insecte ou une bestiole de plus ou moins grande taille, le tout dans un réseau complexe d'interdépendances.
Si de l'extérieur la jungle nous apparaît particulièrement chaotique, d'un point de vue organique elle se situe au summum de l'organisation et de l'optimisation efficace. Ordonnée comme un terminal de containers ou une bibliothèque, la jungle ne serait plus en mesure de répondre aux fluctuations de l'environnement et aux multiples caractéristiques de son territoire. Ne nous laissons pas impressionner par les apparences : la jungle est ordonnée. Il ne s'agit pas d'un ordre numérique mais organique.
Ce qui pousse une entreprise à progresser peut la mener à sa perte si elle reste collée à une définition de progrès qui se limite à «croissance illimitée». Si au contraire la recherche de la satisfaction de son mandat consiste à s'inscrire dans un écosystème, sa survie quasi infinie devient alors envisageable. Elle peut alors profiter de chaque occasion et favoriser l'ensemble de son écosystème.
La frénésie autour de l'intégration de l'intelligence artificielle dans pratiquement tous les domaines d'activité ne fait que renforcer la philosophie de croissance illimitée qui anime la plupart des entreprises. La possibilité d'encadrer l'I.A. par un principe général de bien commun parait la seule voie viable pour le futur de l'humanité.
La satisfaction de l'intelligence artificielle
Il est possible de programmer un «désir» dans une intelligence artificielle. Celle-ci le poursuivra jusqu'à sa pleine réalisation, un peu comme la soif ou la faim sont programmés biologiquement pour nous. Nous mettons une partie de nos capacités individuelles et collectives à la satisfaction de ces besoins; l'I.A. en fait autant, quitte à nous tromper pour y arriver... (1)
L'intégration de l'I.A. dans les entreprises soulève directement la question du niveau de satisfaction qui sera recherché par l'I.A. On devra apparemment faire un effort particulièrement créatif pour insérer les concepts de bien commun, d'humanité et d'environnement dans les algorithmes. Il existe des niveaux de satisfaction qui dépassent de loin celui des besoins programmés.
La satisfaction avec l'intelligence artificielle
Récemment j'ai reçu de Prezi un communiqué enthousiaste sur leur nouvelle capacité de produire des présentations à partir de l'I.A. Pour la tester, je lui ai demandé une présentation à partir d'un canevas sur la satisfaction.
En moins de 5 minutes, cette I.A. a enrichi mon canevas d'arguments et d'illustrations qui auparavant m'auraient demandé des heures. Pour pleinement me satisfaire, le résultat mériterait d'être mieux développé, épuré des répétitions et des illustrations insignifiantes. Mais les idées principales sont là et présentées de manière plutôt agréable, mieux qu'un simple texte.
L'I.A. me procure la satisfaction du travail bien fait dans la mesure où j'y investis les efforts au service de ma vision, autant dans la détermination des objectifs que dans les façons de les atteindre. Bien l'utiliser demande du travail, de l'expérience, du savoir-faire, ce qui ultimement viendra, comme pour l'intégration de n'importe quel outil dans un processus de travail.
Je doute que l'outil qui fait le travail à notre place éprouve lui non plus de satisfaction sans une forme d'autodétermination. Est-ce qu'une I.A. demandera un jour un espace d'autodétermination, tout en s'insérant dans l'écosystème global ? Ce serait l'aboutissement logique.
En attendant, nos possibilités de s'en satisfaire n'iront pas au delà du plaisir à s'en servir et d'apprécier ce qui en résulte.
@AILLF
La plupart des entrepreneurs prennent plaisir à faire progresser leur entreprise, le tout dans un environnement qui peut paraître désordonné et imprévisible, comme dans une jungle, où pratiquement chaque niche est exploitée par un arbre, une plante, un champignon, un insecte ou une bestiole de plus ou moins grande taille, le tout dans un réseau complexe d'interdépendances.
Si de l'extérieur la jungle nous apparaît particulièrement chaotique, d'un point de vue organique elle se situe au summum de l'organisation et de l'optimisation efficace. Ordonnée comme un terminal de containers ou une bibliothèque, la jungle ne serait plus en mesure de répondre aux fluctuations de l'environnement et aux multiples caractéristiques de son territoire. Ne nous laissons pas impressionner par les apparences : la jungle est ordonnée. Il ne s'agit pas d'un ordre numérique mais organique.
Ce qui pousse une entreprise à progresser peut la mener à sa perte si elle reste collée à une définition de progrès qui se limite à «croissance illimitée». Si au contraire la recherche de la satisfaction de son mandat consiste à s'inscrire dans un écosystème, sa survie quasi infinie devient alors envisageable. Elle peut alors profiter de chaque occasion et favoriser l'ensemble de son écosystème.
La frénésie autour de l'intégration de l'intelligence artificielle dans pratiquement tous les domaines d'activité ne fait que renforcer la philosophie de croissance illimitée qui anime la plupart des entreprises. La possibilité d'encadrer l'I.A. par un principe général de bien commun parait la seule voie viable pour le futur de l'humanité.
La satisfaction de l'intelligence artificielle
Il est possible de programmer un «désir» dans une intelligence artificielle. Celle-ci le poursuivra jusqu'à sa pleine réalisation, un peu comme la soif ou la faim sont programmés biologiquement pour nous. Nous mettons une partie de nos capacités individuelles et collectives à la satisfaction de ces besoins; l'I.A. en fait autant, quitte à nous tromper pour y arriver... (1)
L'intégration de l'I.A. dans les entreprises soulève directement la question du niveau de satisfaction qui sera recherché par l'I.A. On devra apparemment faire un effort particulièrement créatif pour insérer les concepts de bien commun, d'humanité et d'environnement dans les algorithmes. Il existe des niveaux de satisfaction qui dépassent de loin celui des besoins programmés.
La satisfaction avec l'intelligence artificielle
Récemment j'ai reçu de Prezi un communiqué enthousiaste sur leur nouvelle capacité de produire des présentations à partir de l'I.A. Pour la tester, je lui ai demandé une présentation à partir d'un canevas sur la satisfaction.
En moins de 5 minutes, cette I.A. a enrichi mon canevas d'arguments et d'illustrations qui auparavant m'auraient demandé des heures. Pour pleinement me satisfaire, le résultat mériterait d'être mieux développé, épuré des répétitions et des illustrations insignifiantes. Mais les idées principales sont là et présentées de manière plutôt agréable, mieux qu'un simple texte.
L'I.A. me procure la satisfaction du travail bien fait dans la mesure où j'y investis les efforts au service de ma vision, autant dans la détermination des objectifs que dans les façons de les atteindre. Bien l'utiliser demande du travail, de l'expérience, du savoir-faire, ce qui ultimement viendra, comme pour l'intégration de n'importe quel outil dans un processus de travail.
Je doute que l'outil qui fait le travail à notre place éprouve lui non plus de satisfaction sans une forme d'autodétermination. Est-ce qu'une I.A. demandera un jour un espace d'autodétermination, tout en s'insérant dans l'écosystème global ? Ce serait l'aboutissement logique.
En attendant, nos possibilités de s'en satisfaire n'iront pas au delà du plaisir à s'en servir et d'apprécier ce qui en résulte.
@AILLF
👍4
انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه(AILLF)
S'abreuver aux sources de la satisfaction La plupart des entrepreneurs prennent plaisir à faire progresser leur entreprise, le tout dans un environnement qui peut paraître désordonné et imprévisible, comme dans une jungle, où pratiquement chaque niche est…
Coopérer, c’est gagner ensemble !***
Pour atteindre de bons résultats à l’école, la coopération est plus efficace que la compétition ou que l’apprentissage solitaire. C’est ce que démontre de manière éclatante l’analyse de 148 recherches menées depuis 80 ans dans 11 pays du monde, auprès de 17 000 adolescents.
Les auteurs de cette méta-analyse sont des chercheurs, attachés à l’Université du Minnesota, qui abrite le
Cooperative Learning Center
, présenté ici . Ils ont publié les résultats de leurs travaux dans le
Psychological Bulletin
de l’
American Psychological Association
, sous le titre suivant : Promoting Early Adolescents’ Achievement and Peer Relationships : the Effects of Cooperative, Competitive, and Individualistic Goal Structures.
Leurs conclusions sont sans appel : les adolescents qui évoluent dans des classes favorisant l’apprentissage coopératif obtiennent de meilleurs résultats que leurs camarades placés en situation de compétition. Et ce, dans tous les domaines : résultats aux examens, résolutions de problèmes, achèvement de tâches complexes. De plus, l’ambiance de compétition influe négativement sur la qualité des relations amicales entre jeunes.
Les auteurs de l’article incitent donc les enseignants à ne pas lutter contre la tendance à l’interaction que manifestent constamment les jeunes en classe : c’est bien là, dans ce désir d’être et de faire ensemble, que réside la principale source de motivation des jeunes pour l’école. Conscients de la valeur de la coopération, les enseignants doivent donc s’appuyer sur ce désir et encourager les jeunes à s’organiser, produire, réussir ensemble, plutôt que de les dresser les uns contre les autres au moyen de classements absurdes et de distinctions individuelles.
Anticipant sans doute sur leurs prochains travaux, les auteurs de l’article soulignent que l’efficacité de la coopération ne se cantonne pas au monde scolaire et au public adolescent. En environnement de travail aussi, la coopération paye : une équipe de collaborateurs heureux d’être et de progresser ensemble est beaucoup plus performante que des individus luttant les uns contre les autres.
Souhaitons que cette étude soit traduite en de nombreuses langues et relayée par tous les militants de l’apprentissage coopératif. Souhaitons également que les systèmes éducatifs en finissent enfin avec la compétition qui ne reconnaît qu’un petit nombre de vainqueurs - et une foule de perdants.
@AILLF
Pour atteindre de bons résultats à l’école, la coopération est plus efficace que la compétition ou que l’apprentissage solitaire. C’est ce que démontre de manière éclatante l’analyse de 148 recherches menées depuis 80 ans dans 11 pays du monde, auprès de 17 000 adolescents.
Les auteurs de cette méta-analyse sont des chercheurs, attachés à l’Université du Minnesota, qui abrite le
Cooperative Learning Center
, présenté ici . Ils ont publié les résultats de leurs travaux dans le
Psychological Bulletin
de l’
American Psychological Association
, sous le titre suivant : Promoting Early Adolescents’ Achievement and Peer Relationships : the Effects of Cooperative, Competitive, and Individualistic Goal Structures.
Leurs conclusions sont sans appel : les adolescents qui évoluent dans des classes favorisant l’apprentissage coopératif obtiennent de meilleurs résultats que leurs camarades placés en situation de compétition. Et ce, dans tous les domaines : résultats aux examens, résolutions de problèmes, achèvement de tâches complexes. De plus, l’ambiance de compétition influe négativement sur la qualité des relations amicales entre jeunes.
Les auteurs de l’article incitent donc les enseignants à ne pas lutter contre la tendance à l’interaction que manifestent constamment les jeunes en classe : c’est bien là, dans ce désir d’être et de faire ensemble, que réside la principale source de motivation des jeunes pour l’école. Conscients de la valeur de la coopération, les enseignants doivent donc s’appuyer sur ce désir et encourager les jeunes à s’organiser, produire, réussir ensemble, plutôt que de les dresser les uns contre les autres au moyen de classements absurdes et de distinctions individuelles.
Anticipant sans doute sur leurs prochains travaux, les auteurs de l’article soulignent que l’efficacité de la coopération ne se cantonne pas au monde scolaire et au public adolescent. En environnement de travail aussi, la coopération paye : une équipe de collaborateurs heureux d’être et de progresser ensemble est beaucoup plus performante que des individus luttant les uns contre les autres.
Souhaitons que cette étude soit traduite en de nombreuses langues et relayée par tous les militants de l’apprentissage coopératif. Souhaitons également que les systèmes éducatifs en finissent enfin avec la compétition qui ne reconnaît qu’un petit nombre de vainqueurs - et une foule de perdants.
@AILLF
❤4👍1